لغة فرنسية
Topic outline
-
-
-
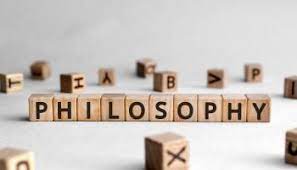
niveau 2éme année philosophie
semestre 2
unité d'enseignement transversale
matière: français
coefficient : 01
crédit : 01
-

Dr SI BACHIR MOHAMED
Département des sciences sociales
faculté des sciences sociales et humaines
Université djilali bounaama
m.si-bachir@univ-dbkm.dz
jours de réception: tous les jours
-
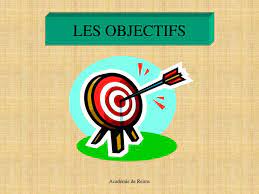
l'objectif principale dans l'enseignement des langues étrangère et d'accroitre la capacité des étudiant à lire et maitriser le texte en français ainsi qu'une analyse détaillé de son contenu
-

la maitrise de la langue française repose essentiellement su la lecture continue pour acquérir un stock lexical sensé aider l'étudiant dans ce domaine
-

Le programme comporte 03 textes
-

-
Amour de la sagesse ou recherche du savoir ?
Le texte :
La philosophie – du grec philein, << aimer >>, et sophia, << sagesse >> - comporte une première ambigüité due au double sens de la << sagesse >> et de << savoir >> de la sophia : la philosophie est, en premier lieu, l’amour de la sagesse ; mais elle est aussi l’effort pour acquérir une conception d’ensemble de l’univers, ou de l’universalité des choses. Sans doute le premier aspect - pratique - n’est-il pas dissociable du second : tout effort pour élaborer une règle de vie, pour adopter une attitude réfléchie et responsable implique une réflexion critique et une interrogation sur les conditions de possibilité d’un savoir. Il y a néanmoins un contraste flagrant entre la sagesse dite socratique – indissociable de la personnalité, de l’esprit voire même de l’ironie de la personne de Socrate – et la définition aristotélicienne de la philosophie, par exemple. Science des premiers principes et des premières causes, la philosophie est également pour Aristote la << science maitresse >> ou << science de l’universel >> ; or << la connaissance de toute les choses appartient nécessairement à celui qui possède au plus haut degré la << science de l’universel >>. La philosophie aristotélicienne est donc une << science dominatrice >> ; et ce n’est pas au sage de recevoir des lois, c’est au contraire à lui d’en donner.
-
-
UNE EXPERIENCE
Le texte :
L’auteur est un illustre savant français mort en 1878. Il fit faire, en vingt ans, plus de progrès à la connaissance de l’organisme humain que tous les médecins des siècles passés. Dans une langue simple, il rend compte ici d’une de ses expériences capitales.
On apporta un jour dans mon laboratoire des lapins venant du marché. On les plaça sur une table ou ils urinèrent et j’observai par hasard que leur urine était claire et acide.
Ce qui me frappa, parce que les lapins ont ordinairement l’urine trouble et alcaline en leur qualité d’herbivores, tandis que les carnivores ainsi qu’on le sait, ont, au contraire, les urines claires et acides.
Cette observation d’acidité de l’urine chez les lapins me fit venir la pensée que ces animaux devaient être dans la condition alimentaire des carnivores. Je supposai qu’ils n’avaient probablement pas mangé depuis longtemps et qu’ils se trouvaient ainsi transformés par l’abstinence en véritables animaux carnivores vivant de leur propre sang. Rien n’était plus facile que de vérifier par l’expérience cette idée préconçue ou cette hypothèse.
Je donnai de l’herbe à manger aux lapins, et quelques heures après, leurs urines étaient devenues troubles et alcalines. On soumit ensuite les mêmes lapins à l’abstinence et, après vingt-quatre heures ou trente-six heures au plus, leurs urines étaient redevenues claires et fortement acides ; puis elles redevenaient de nouveau alcalines en leur donnant de l’herbe, etc.
Je répétai cette expérience si simple un grand nombre de fois sur les lapins et toujours avec le même résultat. Je la répétai ensuite chez le cheval, animal herbivore chez qui l’abstinence produit, comme chez le lapin, une prompte acidité de l’urine…
J’arrivai ainsi à la suite de mes expériences, à cette proposition générale, qui alors n’était pas connue, à savoir qu’à jeun, tous les animaux se nourrissent de viande, de sorte que les herbivores ont alors des urines semblables à celles des carnivores…
Quand on voit un phénomène qu’on a pas l’habitude de voir, il faut toujours se demander à quoi il peut tenir, ou autrement dit, quelle en es la cause prochaine. Alors il se présente à l’esprit une réponse ou une idée qu’il s’agit de soumettre à l’expérience. En voyant l’urine acide chez les lapins, je me suis demandé instinctivement quelle pouvait en être la cause. Le raisonnement que j’ai fait est le suivant : les urines des carnivores sont acides ; or les lapins que j’ai sous les yeux ont les urines acides, donc ils sont carnivores, c’est-à-dire à jeun. C’est ce qu’il fallait établir par l’expérience.
Claude Bernard
Introduction à l’étude de la médecine expérimentale -
-
L’esprit humain
ou le passage du sentiment a la raison puis
a l’expérience
Le texte :
L’esprit humain, aux diverses périodes de son évolution, a passé successivement par le sentiment, la raison et l’expérience. D’abord le sentiment seul s’imposant à la raison créa les vérités de foi, c’est-à-dire la théologie. La raison ou la philosophie, devenant ensuite la maitresse, enfanta la scolastique. Enfin l’expérience, c’est-à-dire l’étude des phénomènes naturels, apprit à l’homme que les vérités du monde extérieur ne se trouvent formulées de prime abord ni dans le sentiment ni dans la raison. Ce sont seulement nos guides indispensables ; mais, pour obtenir ces vérités, il faut nécessairement descendre dans la réalité objective des choses ou elles se trouvent cachées avec leur forme phénoménale.
C’est ainsi qu’apparut par le progrès naturel des choses la méthode expérimentale qui résume tout et qui, comme nous le verrons bientôt, s’appuie successivement sur les trois branches de ce trépied immuable : le sentiment, la raison et l’expérience. Dans la recherche de la vérité, au moyen de cette méthode, le sentiment a toujours l’initiative, il engendre l’idée a priori ou l’intuition ; la raison ou le raisonnement développe ensuite l’idée et déduit ses conséquences logiques. Mais si le sentiment doit être éclairé par les lumières de la raison, la raison à son tour doit être guidée par l’expérience.
Claude BERNARD
Introduction à l’étude de la médecine expérimentale
-
-

-
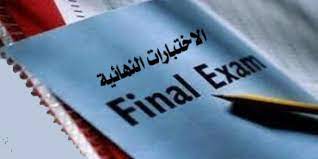
-
Opened: Thursday, 18 May 2023, 12:00 AMDue: Thursday, 25 May 2023, 12:00 AM
à qui appartient la connaissance de toute les choses ?
Qu’a découvert Claude Bernard quand les lapins urinèrent ?
Sur quoi s’appuie la méthode expérimentale ?
-
-
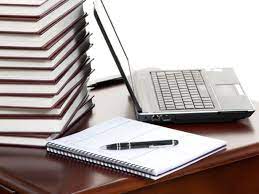
Cours de philosophie par : Armand Culliver_
- Philosphie Terminales AetB par : Elisaeth Clément
